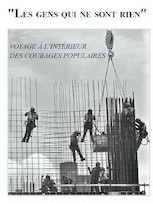Crâne rasé, jean et baskets, Mickaël Stoll, 34 ans, nous reçoit dans les locaux des « Sons d'la rue », une association qui développe la culture hip-hop dans les quartiers de Strasbourg. Les murs sont couverts d'affiches de spectacles. Parmi elles, Samudaripen. Un nom qui, en romani, désigne le génocide tsigane. Un épisode de l'Histoire souvent ignoré, éclipsé par la Shoah. Ce jeune chorégraphe en a fait un spectacle, une rencontre entre danse hip-hop et jazz manouche, entre son enfance au pied des tours et ses origines manouches.
Le hip-hop, Mickaël est tombé dedans tout petit. A l'âge de 2 ans, il quitte le campement manouche de Mertzwiller, un petit village du Bas-Rhin, pour venir s'installer avec sa mère et sa sœur à Cronenbourg, un quartier HLM de Strasbourg. Il découvre le hip-hop par hasard, grâce à l'émission H.I.P.HO.P., présentée par Sidney sur TF1, « tous les samedis soirs, après Starsky et Hutch ». En CP, il assiste à un spectacle de hip-hop avec sa classe. Sur la scène de la salle polyvalente, un de ses voisins. « Il tournait sur la tête, il faisait du robot... j'ai tout de suite accroché », se souvient-il. C'est le funkstyle. Il devient fan des clips de Mickaël Jackson, dont les chorégraphies ont été créées par les Electric Boogaloos, un groupe de jeunes danseurs de rue de Fresno, en Californie.
A 12 ans, Mickaël déménage à l'Elsau, un autre quartier HLM de Strasbourg. C'est là qu'il rencontre Yan Gilg, un animateur du centre culturel du quartier passionné de hip-hop. Il fait venir des professeurs de hip-hop pour donner des cours à l'Elsau, emmène les jeunes aux Rencontres de danses urbaines à la Villette à Paris... « Il voulait nous montrer que c'était possible de nous professionnaliser. » En 1996, Mickaël et ses camarades forment Magic Electro, un groupe de danseurs qui va donner des cours dans les MJC et les écoles. « Quand on traversait le quartier pour aller à la salle de danse, on essayait de ramener le plus de jeunes possible avec nous pour ne pas qu'ils restent dans la rue à faire des conneries. On a sauvé une génération », se félicite-t-il. Deux jeunes du quartier, qui ont maintenant la trentaine, ont même fondé leur propre compagnie, Mistral Est.
« Le hip-hop m'a sorti de la rue »
Le hip-hop, Mickaël est tombé dedans tout petit. A l'âge de 2 ans, il quitte le campement manouche de Mertzwiller, un petit village du Bas-Rhin, pour venir s'installer avec sa mère et sa sœur à Cronenbourg, un quartier HLM de Strasbourg. Il découvre le hip-hop par hasard, grâce à l'émission H.I.P.HO.P., présentée par Sidney sur TF1, « tous les samedis soirs, après Starsky et Hutch ». En CP, il assiste à un spectacle de hip-hop avec sa classe. Sur la scène de la salle polyvalente, un de ses voisins. « Il tournait sur la tête, il faisait du robot... j'ai tout de suite accroché », se souvient-il. C'est le funkstyle. Il devient fan des clips de Mickaël Jackson, dont les chorégraphies ont été créées par les Electric Boogaloos, un groupe de jeunes danseurs de rue de Fresno, en Californie.
A 12 ans, Mickaël déménage à l'Elsau, un autre quartier HLM de Strasbourg. C'est là qu'il rencontre Yan Gilg, un animateur du centre culturel du quartier passionné de hip-hop. Il fait venir des professeurs de hip-hop pour donner des cours à l'Elsau, emmène les jeunes aux Rencontres de danses urbaines à la Villette à Paris... « Il voulait nous montrer que c'était possible de nous professionnaliser. » En 1996, Mickaël et ses camarades forment Magic Electro, un groupe de danseurs qui va donner des cours dans les MJC et les écoles. « Quand on traversait le quartier pour aller à la salle de danse, on essayait de ramener le plus de jeunes possible avec nous pour ne pas qu'ils restent dans la rue à faire des conneries. On a sauvé une génération », se félicite-t-il. Deux jeunes du quartier, qui ont maintenant la trentaine, ont même fondé leur propre compagnie, Mistral Est.

« Créer un échange entre gadjé et Gitans »
En 1998, Mickaël danse dans le spectacle « Haine et respect » qui allie rap, hip-hop et graff. Il tourne dans toute la France et même à l'étranger : Pays-Bas, Allemagne, Maroc... Le danseur, jusqu'alors emploi-jeune, devient intermittent du spectacle. En 2000, Magic Electro devient une compagnie à part entière. Ils enchaînent les créations, jusqu'à leur séparation en 2006. « On était ensemble depuis tout petits, on avait besoin de faire autre chose, de réaliser des projets plus personnels », explique Mickaël, qui rejoint alors la compagnie Mémoires Vives, récemment créée par son ami et mentor Yan Gilg. Sa démarche est originale : à travers la danse hip-hop, elle met en lumière des pans oubliés de notre Histoire nationale, tels que la colonisation, les tirailleurs sénégalais, la guerre d'Algérie...
« J'ai toujours voulu faire un spectacle sur les Tziganes, confie Mickaël, pour briser les tabous ancrés dans l'inconscient collectif. » Un jour, alors que son grand frère entame Minor Swing de Django Reinhardt, il essaie de danser dessus. C'est le déclic. « Je me suis rendu compte qu'il y avait la même sensibilité entre le hip-hop et le jazz manouche, la même liberté d'aller où on veut dans les gestes et dans les notes, la même puissance. » Ni une ni deux, il poste la vidéo sur Internet. Les réactions sont bonnes, aussi bien côté jazz que côté hip-hop. Mickael décide donc de créer « un échange entre gadjé* et Gitans », en embarquant dans l'aventure ses deux petits frères, Billy et Gaga Weiss, musiciens de jazz manouche.
« J'ai toujours voulu faire un spectacle sur les Tziganes, confie Mickaël, pour briser les tabous ancrés dans l'inconscient collectif. » Un jour, alors que son grand frère entame Minor Swing de Django Reinhardt, il essaie de danser dessus. C'est le déclic. « Je me suis rendu compte qu'il y avait la même sensibilité entre le hip-hop et le jazz manouche, la même liberté d'aller où on veut dans les gestes et dans les notes, la même puissance. » Ni une ni deux, il poste la vidéo sur Internet. Les réactions sont bonnes, aussi bien côté jazz que côté hip-hop. Mickael décide donc de créer « un échange entre gadjé* et Gitans », en embarquant dans l'aventure ses deux petits frères, Billy et Gaga Weiss, musiciens de jazz manouche.

« Briser les tabous ancrés dans l'inconscient collectif »
C'est Yan Gilg qui apporte la thématique de l'internement des Tsiganes, autre aspect méconnu de l'histoire récente. Un thème tabou dans la culture manouche. « On ne parle pas de nos morts, explique Mickaël ; on a tendance à laisser le passé derrière nous. » Il en parle avec sa famille, qui accepte. En fouillant les archives de l'Ina, il tombe sur un micro-trottoir datant de la fin des années 1970, filmé justement à Mertzwiller, là où vivait sa famille. « Tous les stéréotypes y étaient : voleurs de poules, voleurs d'enfants... Et je me suis rendu compte que même plus de 30 ans après, les gens pensaient toujours comme ça, et qu'il fallait briser toute cette pensée. »
C'est ainsi qu'est née Samudaripen, en 2010. Une pièce pour quatre danseurs – dont Mickaël –, trois musiciens et un chanteur-comédien – Yan Gilg –, dont l'action se déroule dans un camp de concentration. Quand le jazz manouche ne colle pas à la gravité de l'instant, Jean-Baptiste Boley, pianiste et contrebassiste de jazz, « un gadjo* », fait des incursions dans le répertoire classique. Il faut « casser les codes, insiste Mickaël, pour que ça parle plus aux gens ». Des vidéos d'archives et des textes slamés, basés sur des écrits de prisonniers, replacent le spectacle dans son contexte historique, tandis que les danseurs évoluent en uniforme rayé.
C'est ainsi qu'est née Samudaripen, en 2010. Une pièce pour quatre danseurs – dont Mickaël –, trois musiciens et un chanteur-comédien – Yan Gilg –, dont l'action se déroule dans un camp de concentration. Quand le jazz manouche ne colle pas à la gravité de l'instant, Jean-Baptiste Boley, pianiste et contrebassiste de jazz, « un gadjo* », fait des incursions dans le répertoire classique. Il faut « casser les codes, insiste Mickaël, pour que ça parle plus aux gens ». Des vidéos d'archives et des textes slamés, basés sur des écrits de prisonniers, replacent le spectacle dans son contexte historique, tandis que les danseurs évoluent en uniforme rayé.

Connaître l'Histoire pour mieux se connaître soi-même
« C'est un spectacle frontal, comme un documentaire », explique Mickaël. Jouée dans de nombreuses salles à travers la France, la pièce est systématiquement suivie d'un débat. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils entendent parler du génocide tzigane. « Bravo, il était temps qu'on en parle », saluent les Manouches ayant assisté à la représentation. De nombreux professeurs y emmènent leurs élèves. Parfois, Mickaël se heurte au refus des programmateurs. « C'est un spectacle qui gêne un peu, admet-il, c'est quand même une dénonciation, et certains programmateurs ont peur de se mouiller. »
Au-delà du travail de mémoire, Samudaripen a permis à Mickaël de mieux se connaître lui-même, et de comprendre l'histoire de sa famille. De comprendre pourquoi sa grand-mère, lorsqu'elle voyait les gendarmes arriver sur le terrain de Mertzwiller, prenait son fusil pour tirer en l'air : ils lui rappelaient les gendarmes qui gardaient le camp de Rivesaltes, où elle a été internée pendant la Seconde guerre mondiale. Elle ne lui en avait jamais parlé. En retrouvant ses racines, il a compris le sens de ses angoisses, de « ces murs qui [l']enfermaient. Quand j'allais chez mon père (sur le terrain de Mertzwiller, ndlr), je me sentais libre, ma grand-mère me transmettait ses valeurs. » Rapport avec la nature, sens de la famille, solidarité, simplicité, pauvreté... « toutes ces valeurs que le capitalisme nous a fait oublier. »
Au-delà du travail de mémoire, Samudaripen a permis à Mickaël de mieux se connaître lui-même, et de comprendre l'histoire de sa famille. De comprendre pourquoi sa grand-mère, lorsqu'elle voyait les gendarmes arriver sur le terrain de Mertzwiller, prenait son fusil pour tirer en l'air : ils lui rappelaient les gendarmes qui gardaient le camp de Rivesaltes, où elle a été internée pendant la Seconde guerre mondiale. Elle ne lui en avait jamais parlé. En retrouvant ses racines, il a compris le sens de ses angoisses, de « ces murs qui [l']enfermaient. Quand j'allais chez mon père (sur le terrain de Mertzwiller, ndlr), je me sentais libre, ma grand-mère me transmettait ses valeurs. » Rapport avec la nature, sens de la famille, solidarité, simplicité, pauvreté... « toutes ces valeurs que le capitalisme nous a fait oublier. »

« Ce que l'être humain recherche au fond de lui, c'est le voyage »
Il y a quelques années, Mickaël est retourné vivre à Mertzwiller. « Je passais à la télévision, je m'en étais sorti. Je voyais la lumière dans les yeux des gamins », se souvient-il. Ni une ni deux, il se présente à la mairie, son dossier de presse sous le bras : « Donnez-moi une salle, et je fais gratuitement des choses pour eux, je leur apprends à s'intégrer tout doucement. » Ils ne l'ont jamais rappelé. Selon lui, le seul moyen de s'intégrer sans trahir sa culture, c'est la pratique artistique, « parce qu'on est libre, et qu'on est estimé pour ce que l'on est. » Mais les écoles de jazz ont disparu.
« Ils ont coupé toutes les subventions », regrette-t-il. Depuis, la situation a empiré à Mertzwiller. Le service de ramassage des déchets a cessé de fonctionner, et le camp devient insalubre. « On ne fait plus rien pour eux, on va les laisser mourir ».
Même si aujourd'hui, il a fait sa vie en-dehors de la communauté manouche, le jeune chorégraphe continue à croire que « ce que l'être humain recherche au fond de lui, c'est le voyage. Regardez, même ceux qui travaillent tous les jours, qu'est-ce qu'ils attendent ? Les grandes vacances, quand on s'aère, qu'on part à la plage... » Ne serions-nous pas tous, au fond, un peu manouches ?
Marion Bastit
* Un gadjo (gadjé au pluriel) désigne un non-Tzigane en romani.
« Ils ont coupé toutes les subventions », regrette-t-il. Depuis, la situation a empiré à Mertzwiller. Le service de ramassage des déchets a cessé de fonctionner, et le camp devient insalubre. « On ne fait plus rien pour eux, on va les laisser mourir ».
Même si aujourd'hui, il a fait sa vie en-dehors de la communauté manouche, le jeune chorégraphe continue à croire que « ce que l'être humain recherche au fond de lui, c'est le voyage. Regardez, même ceux qui travaillent tous les jours, qu'est-ce qu'ils attendent ? Les grandes vacances, quand on s'aère, qu'on part à la plage... » Ne serions-nous pas tous, au fond, un peu manouches ?
Marion Bastit
* Un gadjo (gadjé au pluriel) désigne un non-Tzigane en romani.



 Engagés
Engagés