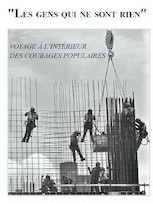Anne Lecourt a pris la plume pour donner parole à nos mères et grands-mères ainsi qu'il a été raconté dans son portrait. Comme en prolongement de ce dernier, elle a accepté de partager avec les lectrices et lecteurs d'Histoires Ordinaires le récit de vie de Madeleine. Dans la préface de son livre "Les Discrètes, paroles de Bretonnes", Anne Lecourt explique ainsi comment elle aborde ces rencontres. Peut-être une bonne façon, aussi, d'entrer dans ce récit... »
« Guetter le tout premier frémissement. Apprendre la patience, saisir l'instant, encourager d'un regard. Observer, retenir. Laisser venir. Un voile dans la voix, la crispation d'une lèvre, l'irritation d'une tasse vite reposée, une bouche qui se cache pour sourire, l'ébauche d'un geste, une main, qui corrige, qui écarte, ou qui retombe, sans rien livrer. »
« Maman était épicière. On disait « je vais chez Prudence ». Faire les commissions. Elle cousait aussi, confectionnait les parures de lit et les robes de mariées. J'adorais jouer à la balançoire dans les draps neufs ! Dans le magasin, il y avait plein de choses à manger, et puis tout un bric-à-brac d'objets. Je me souviens du bac à sel tout suintant d'humidité – on vendait le sel en vrac – des articles de quincaillerie, du tissu, du fil et des boutons, des casseroles brillantes et de la vaisselle emballée, des garde-manger, … des chaussons ! Maman faisait griller le café dehors, sur la rue – c'était long, ça lui permettait de lire, elle adorait ça. Elle venait du côté de Chavagne d'une famille de dix enfants, si pauvre qu'ils dînaient d'un hareng pour trois. »
Septembre 1939. Un monde entre en guerre.
Bris d'images. Tocsin. Piaillement des plus petits, tirés, ballottés sans ménagement, ricochets de voix tremblées sur les façades de pierre. L'ordre de mobilisation placardé, des visages adultes flottant au-dessus de la fillette, tendus, déformés, méconnaissables. Son père avait fait la grande Guerre. Il s'était trouvé enterré après la chute d'un obus tombé tout près, il en avait gardé des séquelles, un éclat mystérieux, dans le dos croyait-elle savoir. Madeleine Bougeard se souvient, elle a neuf ans. Et aussi comment ses parents ne la trouvant pas lorsque les Allemands étaient entrés dans Talensac s'étaient mis à crier après elle, et dans leur affolement l'avaient giflée au sortir des toilettes où elle rêvassait, ou peut-être même pas.
Images de soldats à la maison qui viennent faire leur popote, cuire les œufs du matin, par dizaines, un officier souriant, à qui l'on a donné sa chambre. La famille entassée dans l'étroite bâtisse de pierre violette au cœur même du bourg, la petite fille envoyée dans le lit de la bonne, le tout serré dans la grande chambre des parents. Après un toit, ils avaient réquisitionné les vélos. N'avaient récolté qu'une poignée de vieux clous aussi dignes qu'enrouillés – les beaux étaient à l'abri ! Le père Bougeard d'ailleurs avait pris les devants et démonté les jantes de la Mona 4 – au moins une que les « Boches » n'auraient pas - s'était prétendu dépouillé par des Allemands d'avant ceux-là, « Ce sont vos amis qui m'ont tout pris » avait-il expliqué à grand renfort de gestes et parlant fort, comme si les autres étaient sourds. Il était charron, et faisait le cidre. Son atelier non loin du cimetière, un jardin pour ses légumes, une passion pour les montres.
Les Allemands s'étaient installés dans l'église pour dominer le pays. Deux chambres dans les combles du vénérable édifice. Dessous, le beau pays de Talensac comme un tapis déroulé. En pleine ligne de mire. Images d'uniformes en bleu et vert de gris fréquentant le « Casino » – une maison dans le bourg, où jouer, se divertir, avec des femmes, des Françaises, le soir. Et cela plein de rire et de vin qui mène grand tapage jusqu'à pas d'heure. Couvre-feu pour les autres. Une prison aussi - très organisés ces gens-là - aménagée dans une cave pour leurs « mauvais » soldats. Le Château de Bintin pour les plus « méritants ». La municipalité française courtoise et partagée. On ne sait pas toujours de quel côté de la guerre se mettre. Les autres sont laissés tranquilles mais l'école publique, elle, est occupée. Les garçons et les filles de l'assistance se sont retranchés dans un grenier à « la Lande », route de St Péran avec l'instituteur qui s'accroche à ses ouailles. Annick sa fille. La grande copine de Madeleine. Des affamées de lectures toutes les deux.
Ein, zwei, drei, vier, Madeleine apprend à compter, observe, enregistre, fascinée. Elle est curieuse, Madeleine, elle a le goût du savoir, récite sur le bout des doigts des pages entières des livres de la bibliothèque alignés au presbytère. Écoute la radio, très vite se forge une opinion personnelle, tient tête à son père - qui n'aime pas l'école et l'a près du bonnet. « Mon père quand il se mettait en colère il montait dans ma chambre pour déchirer mes livres. Il disait que ça me donnait de mauvaises idées, que ça finirait mal. » Heures crispées. Images de réfugiés, indigents, des nuées dispersées sur la commune. Certains venant de Rennes, d'autres de Paris. Parmi les Français les mouchards, climat de méfiance à l'épicerie. Madeleine se souvient de certaines femmes venant faire leurs commissions, et du même coup répandre certains bruits, se plaindre de certaines choses, mine de rien, critiquant l'occupant, histoire de sonder. La mère de Madeleine était très prudente « surtout tiens ta langue » disait-elle à sa fille. Oui, un petit nombre était bien avec l'occupant. Commerces en tous genres, certains plus laids encore que d'autres, sous le manteau, dans les châteaux. Le marché noir comme par un fait obligé, fleurissait partout autour des fermes. La faim épargnant les campagnes, et ravageant les villes. Certains partis nourrir Paris. Quelques-uns faisant leur beurre de la guerre. D'autres y laissant leur peau, ou leur honneur. C'était le temps des semelles de carton dans les chaussures, des bons de rationnement, des colis de prisonniers.
Chez les Bougeard, dans les faux-plafonds, le père entasse la marchandise. Peur de manquer. Dans un tournant de la guerre, la petite Madeleine se souvient, stupéfiée, d'un homme prostré, qui pleure dans ses mains et qui plie face à l'histoire jouée au loin. C'est l'officier allemand, l'homme souriant qui dormait dans le lit de fer de la fillette. Il explique à la famille le petit garçon qu'il ne verra pas grandir, il part, demain, pour le front russe. « On disait de Pétain qu'il était vendu aux Boches. On ne savait rien de la résistance. On s'en méfiait presque autant que de la Milice, comment savoir. On était triste. On avait peur. » Peur des Français. De la spirale mortelle, dénonciation, emprisonnement, torture et mort. On se souvient d'un corps supplicié ramené à Talensac, celui d'André Leclerc, chef de la résistance. Il y en a eu d'autres, nombreux, hommes et femmes, à périr par cette milice enragée aux ordres d'un certain Schwaller à Rennes, à Fougères, à Mordelles ou à Talensac. Après le débarquement encore. Images troubles de la libération. Règlements de compte dans les campagnes. Certains règlements, certains comptes. Désordre et pulsions. Un milicien rasé. Une femme qu'on veut tondre. Et puis l'après 45, les Allemands prisonniers dans les fermes. Tout le jour et par tous les temps dehors cassent des cailloux, construisent nos routes, effacent les vieux chemins de terre. Vainqueurs et vaincus tirant la même charrette, trimant pareillement. Visages durs, corps harassés, noirs de crasse, lampées de cidre à même la bouteille, paillasses enfiévrées, sueurs jumelles. La guerre est finie. Madeleine a quinze ans.
Madeleine n'a pas eu son Certificat d'études. Elle n'est pas devenue institutrice comme elle en rêvait. Elle n'a pas suivi Annick au lycée, rue Martenot à Rennes. Elle a espéré jusqu'au bout. Mais son père dont le métier accusait le coup sous la pression de la mécanisation a décidé qu'elle resterait au magasin, auprès de sa mère « tu crois pas qu'on va payer une employée pour faire le boulot non ? ». Il venait de perdre sa fille aînée, la sœur de Madeleine, emportée à 21 ans par une fièvre infectieuse, complication ordinaire d'un accouchement de ce temps-là. Une douleur sourde, un chagrin envenimé le rongeait en dedans, qu'il promenait partout avec lui, un autre désormais.
Bris d'images. Tocsin. Piaillement des plus petits, tirés, ballottés sans ménagement, ricochets de voix tremblées sur les façades de pierre. L'ordre de mobilisation placardé, des visages adultes flottant au-dessus de la fillette, tendus, déformés, méconnaissables. Son père avait fait la grande Guerre. Il s'était trouvé enterré après la chute d'un obus tombé tout près, il en avait gardé des séquelles, un éclat mystérieux, dans le dos croyait-elle savoir. Madeleine Bougeard se souvient, elle a neuf ans. Et aussi comment ses parents ne la trouvant pas lorsque les Allemands étaient entrés dans Talensac s'étaient mis à crier après elle, et dans leur affolement l'avaient giflée au sortir des toilettes où elle rêvassait, ou peut-être même pas.
Images de soldats à la maison qui viennent faire leur popote, cuire les œufs du matin, par dizaines, un officier souriant, à qui l'on a donné sa chambre. La famille entassée dans l'étroite bâtisse de pierre violette au cœur même du bourg, la petite fille envoyée dans le lit de la bonne, le tout serré dans la grande chambre des parents. Après un toit, ils avaient réquisitionné les vélos. N'avaient récolté qu'une poignée de vieux clous aussi dignes qu'enrouillés – les beaux étaient à l'abri ! Le père Bougeard d'ailleurs avait pris les devants et démonté les jantes de la Mona 4 – au moins une que les « Boches » n'auraient pas - s'était prétendu dépouillé par des Allemands d'avant ceux-là, « Ce sont vos amis qui m'ont tout pris » avait-il expliqué à grand renfort de gestes et parlant fort, comme si les autres étaient sourds. Il était charron, et faisait le cidre. Son atelier non loin du cimetière, un jardin pour ses légumes, une passion pour les montres.
Les Allemands s'étaient installés dans l'église pour dominer le pays. Deux chambres dans les combles du vénérable édifice. Dessous, le beau pays de Talensac comme un tapis déroulé. En pleine ligne de mire. Images d'uniformes en bleu et vert de gris fréquentant le « Casino » – une maison dans le bourg, où jouer, se divertir, avec des femmes, des Françaises, le soir. Et cela plein de rire et de vin qui mène grand tapage jusqu'à pas d'heure. Couvre-feu pour les autres. Une prison aussi - très organisés ces gens-là - aménagée dans une cave pour leurs « mauvais » soldats. Le Château de Bintin pour les plus « méritants ». La municipalité française courtoise et partagée. On ne sait pas toujours de quel côté de la guerre se mettre. Les autres sont laissés tranquilles mais l'école publique, elle, est occupée. Les garçons et les filles de l'assistance se sont retranchés dans un grenier à « la Lande », route de St Péran avec l'instituteur qui s'accroche à ses ouailles. Annick sa fille. La grande copine de Madeleine. Des affamées de lectures toutes les deux.
Ein, zwei, drei, vier, Madeleine apprend à compter, observe, enregistre, fascinée. Elle est curieuse, Madeleine, elle a le goût du savoir, récite sur le bout des doigts des pages entières des livres de la bibliothèque alignés au presbytère. Écoute la radio, très vite se forge une opinion personnelle, tient tête à son père - qui n'aime pas l'école et l'a près du bonnet. « Mon père quand il se mettait en colère il montait dans ma chambre pour déchirer mes livres. Il disait que ça me donnait de mauvaises idées, que ça finirait mal. » Heures crispées. Images de réfugiés, indigents, des nuées dispersées sur la commune. Certains venant de Rennes, d'autres de Paris. Parmi les Français les mouchards, climat de méfiance à l'épicerie. Madeleine se souvient de certaines femmes venant faire leurs commissions, et du même coup répandre certains bruits, se plaindre de certaines choses, mine de rien, critiquant l'occupant, histoire de sonder. La mère de Madeleine était très prudente « surtout tiens ta langue » disait-elle à sa fille. Oui, un petit nombre était bien avec l'occupant. Commerces en tous genres, certains plus laids encore que d'autres, sous le manteau, dans les châteaux. Le marché noir comme par un fait obligé, fleurissait partout autour des fermes. La faim épargnant les campagnes, et ravageant les villes. Certains partis nourrir Paris. Quelques-uns faisant leur beurre de la guerre. D'autres y laissant leur peau, ou leur honneur. C'était le temps des semelles de carton dans les chaussures, des bons de rationnement, des colis de prisonniers.
Chez les Bougeard, dans les faux-plafonds, le père entasse la marchandise. Peur de manquer. Dans un tournant de la guerre, la petite Madeleine se souvient, stupéfiée, d'un homme prostré, qui pleure dans ses mains et qui plie face à l'histoire jouée au loin. C'est l'officier allemand, l'homme souriant qui dormait dans le lit de fer de la fillette. Il explique à la famille le petit garçon qu'il ne verra pas grandir, il part, demain, pour le front russe. « On disait de Pétain qu'il était vendu aux Boches. On ne savait rien de la résistance. On s'en méfiait presque autant que de la Milice, comment savoir. On était triste. On avait peur. » Peur des Français. De la spirale mortelle, dénonciation, emprisonnement, torture et mort. On se souvient d'un corps supplicié ramené à Talensac, celui d'André Leclerc, chef de la résistance. Il y en a eu d'autres, nombreux, hommes et femmes, à périr par cette milice enragée aux ordres d'un certain Schwaller à Rennes, à Fougères, à Mordelles ou à Talensac. Après le débarquement encore. Images troubles de la libération. Règlements de compte dans les campagnes. Certains règlements, certains comptes. Désordre et pulsions. Un milicien rasé. Une femme qu'on veut tondre. Et puis l'après 45, les Allemands prisonniers dans les fermes. Tout le jour et par tous les temps dehors cassent des cailloux, construisent nos routes, effacent les vieux chemins de terre. Vainqueurs et vaincus tirant la même charrette, trimant pareillement. Visages durs, corps harassés, noirs de crasse, lampées de cidre à même la bouteille, paillasses enfiévrées, sueurs jumelles. La guerre est finie. Madeleine a quinze ans.
Madeleine n'a pas eu son Certificat d'études. Elle n'est pas devenue institutrice comme elle en rêvait. Elle n'a pas suivi Annick au lycée, rue Martenot à Rennes. Elle a espéré jusqu'au bout. Mais son père dont le métier accusait le coup sous la pression de la mécanisation a décidé qu'elle resterait au magasin, auprès de sa mère « tu crois pas qu'on va payer une employée pour faire le boulot non ? ». Il venait de perdre sa fille aînée, la sœur de Madeleine, emportée à 21 ans par une fièvre infectieuse, complication ordinaire d'un accouchement de ce temps-là. Une douleur sourde, un chagrin envenimé le rongeait en dedans, qu'il promenait partout avec lui, un autre désormais.

Années cinquante – Un monde est à faire.
Madeleine a quitté l'épicerie pour se marier à un marchand de cochons. Elle est partie vivre avec lui, chez sa mère, à deux kilomètres du bourg de Talensac. Elle a continué ses lectures contrariées et puis elle a donné le jour à un petit garçon, a materné pendant deux ans, et puis dans un sursaut, un besoin pressant de vivre et de bouger, elle a grimpé dans le camion avec son mari. « Mon mari voulait pas au début. Moi je ne tenais plus en place chez ma belle-mère. Vingt-et-un ans on a vécu chez elle ! Je n'avais pas demandé à venir, moi. Je ne voulais pas me marier d'abord. Et puis au Champ picot, y'avait pas l'électricité, je voulais un frigidaire. » « Je suis chez moi » répondait ma belle-mère. Ohlala ça pétait des fois. Elle était têtue, moi aussi. Alors j'ai mis des pantalons et j'ai suivi mon mari dans son métier. On peut dire que j'en ai bavé. À en pleurer. Mon premier jour, c'était une foire à Broons, Pierre me dit « ben vas-y donc, va la voir la bonne femme, demande lui combien elle en veut ». Les porcelets pesaient vingt-cinq, trente ou trente-cinq kilos. Fallait savoir apprécier, négocier, marchander, « chipoter » comme on dit dans le métier. J'avais horreur de ça. Moi je venais d'un monde où un prix était un prix, point. À l'épicerie, on calculait sa marge et on n'en démordait pas. Je restais là à danser d'un pied sur l'autre, j'avais presque honte. »
Madeleine apprend le commerce des bestiaux. Pierre est bon acheteur, il est réputé pour la qualité de ses choix, Madeleine est bonne vendeuse, elle calcule tout - Pierre aurait donné. Ils forment une bonne équipe. « On avait un petit numéro bien rodé. Pierre me poussait devant, j'allais d'abord, je demandais au vendeur combien, puis je tournais le dos, je m'en allais en faisant mine de pester assez fort pour qu'il m'entende « ah vous n'en voulez pas à tel prix, et ben c'est bien dommage... » et puis mon mari plus loin passait derrière moi, pour faire baisser le prix, on finissait par user le vendeur à force ! Parfois notre fils Pierrick s'y mettait aussi. C'était drôle ! Des fois on était reconnu ! le vendeur rigolait « dis donc toi, le père est déjà passé ». Avec le temps, Madeleine s'enhardit, le fils se prend au jeu, et toute la famille fait son théâtre, très à l'aise. Ils achètent, sur les foires, les marchés, et puis revendent. Déchargent dans les fermes des cochons à élever et en échange embarquent des porcs à destination de l'abattoir. Partent de nuit, rentrent de nuit. Jouent les intermédiaires, se payent sur les transactions, montent des bestiaux en gare de Montfort ou de Rennes, les descendent à Paris, dans les Yvelines. Le travail est harassant, les déplacements quotidiens. Auray, Bubry, Rosporden, Quimper, Guéméné/Scorff, Vire. À chaque wagon SNCF rempli ils touchent un billet de transport gratuit. « L'abattoir réglait aux clients et nous on avait une commission de 10 %. Des fois mon mari m'appelait à 4h du matin pour me dire j'ai pris trop de petits veaux, rejoins-moi avec l'autre camion. Je devais partir toute seule dans la nuit, dans le brouillard, sur une route que je ne connaissais pas, fallait être solide. J'ai pleuré souvent. »
Et les cochons, ça peut être fragile, de la casse il y en a eu, surtout avec les Landrace ou les Piétrains, vulnérables sur le plan cardiaque. Ceux-là, il fallait les saigner parce qu'ils souffraient. Madeleine raconte comment la terreur la prenait lorsqu'elle les entendait dans le camion, qui commençaient à crier, elle ne voulait pas croire, elle n'était pas sûre, cherchait comment contourner le problème, mais il fallait bien prendre une décision, rapidement, elle était toute seule avec son angoisse qui montait. Bien obligée de régler ce type de problème, précisément. Comme cette fois sur le quai de la gare de Montfort. Madeleine parle toute seule en faisant les cent pas, le cochon n'arrête pas de crier. Elle a déplacé le wagon déjà, à cause du soleil, il ne faudrait pas qu'ils crèvent là-dedans, à cause de la chaleur, c'est une vraie fournaise lorsque le soleil donne sur la tôle. Avec sa barre de fer elle a l'habitude, elle la coince sous la caisse, s’arque-boute et se suspend de tout son poids – cinquante kilos à tout casser. Lentement le wagon avance. Elle ne supporte plus les cris du cochon qui lui tapent sur les nerfs, lui donnent la nausée, ni la transpiration qui mouille sa chemise, ce train qui n'arrive pas, Pierre toujours à travailler au loin, elle pousse la porte du buffet de la gare, complètement retournée, demande un couteau, très tranchant précise t-elle, et puis revient au wagon, coince sous elle le cochon pour que la tête déborde à l'extérieur, cherche comment s'y prendre, essaie de se souvenir des gestes qu'elle a vu faire le cœur battant donne à l'aveuglette un coup de couteau sous la gorge de l'animal surpris, une fois deux fois trois fois le sang les cris elle essaie encore et encore il ne veut pas se taire le sang les cris la tête qui pend elle est toute seule défaite empoissée les gars de la gare les mains enfoncées dans les poches en connaisseurs c'est pas de pot y'avait que ça à faire, ah ça c'est pas de pot. Madeleine s'essuie les mains, le front, Madeleine se reprend, Madeleine apprend à se faire une place respectée.
Elle passe assez vite son permis de conduire – elle a roulé sans, un certain temps - mais bien moins longtemps que Pierre. Les gendarmes ont attrapé son mari bien des fois, il envoyait Madeleine leur causer, elle devait mentir, prétendre qu'on avait perdu le fameux papier, les gendarmes n'insistaient pas. Au bout d'un certain temps la jeune femme roule seule dans son camion, avec jusqu'à cent petits cochons, ou soixante gros à l'arrière. Avale les kilomètres par centaines en fumant des cigarettes, en secret. C'est lourd à manœuvrer un bahut pareil, c'est dangereux quand la route est mouillée, ou boueuse, elle croit verser plus d'une fois. Un jour dans une courbe du côté de Paimpont, elle a Pierrick avec elle, ses bras et ses jambes tremblent tellement elle se cramponne au volant, elle sent le camion partir dans le virage, il est très chargé, il chasse, mais tient. Il tient, à un cheveu, elle baisse la vitre, sourit à son garçon, respire un grand coup. Chaque jour pendant des heures elle charge et décharge ses porcelets à la main. Quand elle rentre et qu'elle a tout vendu, elle s'inquiète au début des grosses sommes d'argent qu'elle transporte à vélomoteur depuis les Chèques Postaux de Rennes. Elle a cru parfois qu'on allait la dépouiller, des types en auto, qui l'attendent, la dépassent, font un bout de chemin, elle l'a dit à Pierre, il ne faut plus faire comme ça, j'ai peur.
Et puis cette autre fois aussi, elle en rit encore, Madeleine, la plaine de Baud, le triage de la gare de Rennes, ce cochon qui s'est échappé au sortir du wagon, et qui se sauve du côté de la Vilaine. On lui court derrière, il y a Marcel Maudet – un collègue - qui l'accompagne ce jour-là, on l'attrape par la queue, mais plus on tire, et plus il descend vers l'eau, tout le monde glisse, manque de tomber dans la flotte, et voilà le cochon à l'eau, qui nage nom de nom, et puis qui s'assoit au milieu de la Vilaine, comme ça sur une butte, un banc de sable, sur son derrière, qui se retourne et nous regarde, avec ses petits yeux intelligents. Puis il repart vers la berge d'en face, il fonce dans le linge d'une lavandière, il piétine tout le linge de la bonne femme - qui braille -, Madeleine se dit qu'on ne peut pas rester bras ballants, s'en va appeler les pompiers, court autant qu'elle peut, le temps qu'ils arrivent, le cochon est rendu dans le lotissement en face, les gens sont sortis de chez eux, s'interpellent, lèvent les bras, font des barrages, tout le monde fait la chasse au cochon ! « On a fini par l'avoir, on a payé un coup aux pompiers ».
Ils travaillent dur, Pierre et Madeleine, mais ils aiment se faire plaisir aussi. Après le boulot, ils partent en virées à Saint-Malo, vont au resto, traînent jusque tard le soir, elle, à son bras, sautillante, toujours bavarde et si vive, une petite hirondelle. Parfois ils vont à la mer, pique-niquer avec des amis. Se faire bronzer, nager pas trop. Madeleine a eu au début des années soixante un superbe maillot deux-pièces crème – qu'on trouverait exagérément couvrant aujourd'hui mais qui à l'époque lui avait valu d'être critiquée ouvertement, un jour, à Saint-Briac, malgré sa silhouette de sirène elle avait dû remballer ses affaires vite fait, et disparaître, huée presque.
Madeleine a quitté l'épicerie pour se marier à un marchand de cochons. Elle est partie vivre avec lui, chez sa mère, à deux kilomètres du bourg de Talensac. Elle a continué ses lectures contrariées et puis elle a donné le jour à un petit garçon, a materné pendant deux ans, et puis dans un sursaut, un besoin pressant de vivre et de bouger, elle a grimpé dans le camion avec son mari. « Mon mari voulait pas au début. Moi je ne tenais plus en place chez ma belle-mère. Vingt-et-un ans on a vécu chez elle ! Je n'avais pas demandé à venir, moi. Je ne voulais pas me marier d'abord. Et puis au Champ picot, y'avait pas l'électricité, je voulais un frigidaire. » « Je suis chez moi » répondait ma belle-mère. Ohlala ça pétait des fois. Elle était têtue, moi aussi. Alors j'ai mis des pantalons et j'ai suivi mon mari dans son métier. On peut dire que j'en ai bavé. À en pleurer. Mon premier jour, c'était une foire à Broons, Pierre me dit « ben vas-y donc, va la voir la bonne femme, demande lui combien elle en veut ». Les porcelets pesaient vingt-cinq, trente ou trente-cinq kilos. Fallait savoir apprécier, négocier, marchander, « chipoter » comme on dit dans le métier. J'avais horreur de ça. Moi je venais d'un monde où un prix était un prix, point. À l'épicerie, on calculait sa marge et on n'en démordait pas. Je restais là à danser d'un pied sur l'autre, j'avais presque honte. »
Madeleine apprend le commerce des bestiaux. Pierre est bon acheteur, il est réputé pour la qualité de ses choix, Madeleine est bonne vendeuse, elle calcule tout - Pierre aurait donné. Ils forment une bonne équipe. « On avait un petit numéro bien rodé. Pierre me poussait devant, j'allais d'abord, je demandais au vendeur combien, puis je tournais le dos, je m'en allais en faisant mine de pester assez fort pour qu'il m'entende « ah vous n'en voulez pas à tel prix, et ben c'est bien dommage... » et puis mon mari plus loin passait derrière moi, pour faire baisser le prix, on finissait par user le vendeur à force ! Parfois notre fils Pierrick s'y mettait aussi. C'était drôle ! Des fois on était reconnu ! le vendeur rigolait « dis donc toi, le père est déjà passé ». Avec le temps, Madeleine s'enhardit, le fils se prend au jeu, et toute la famille fait son théâtre, très à l'aise. Ils achètent, sur les foires, les marchés, et puis revendent. Déchargent dans les fermes des cochons à élever et en échange embarquent des porcs à destination de l'abattoir. Partent de nuit, rentrent de nuit. Jouent les intermédiaires, se payent sur les transactions, montent des bestiaux en gare de Montfort ou de Rennes, les descendent à Paris, dans les Yvelines. Le travail est harassant, les déplacements quotidiens. Auray, Bubry, Rosporden, Quimper, Guéméné/Scorff, Vire. À chaque wagon SNCF rempli ils touchent un billet de transport gratuit. « L'abattoir réglait aux clients et nous on avait une commission de 10 %. Des fois mon mari m'appelait à 4h du matin pour me dire j'ai pris trop de petits veaux, rejoins-moi avec l'autre camion. Je devais partir toute seule dans la nuit, dans le brouillard, sur une route que je ne connaissais pas, fallait être solide. J'ai pleuré souvent. »
Et les cochons, ça peut être fragile, de la casse il y en a eu, surtout avec les Landrace ou les Piétrains, vulnérables sur le plan cardiaque. Ceux-là, il fallait les saigner parce qu'ils souffraient. Madeleine raconte comment la terreur la prenait lorsqu'elle les entendait dans le camion, qui commençaient à crier, elle ne voulait pas croire, elle n'était pas sûre, cherchait comment contourner le problème, mais il fallait bien prendre une décision, rapidement, elle était toute seule avec son angoisse qui montait. Bien obligée de régler ce type de problème, précisément. Comme cette fois sur le quai de la gare de Montfort. Madeleine parle toute seule en faisant les cent pas, le cochon n'arrête pas de crier. Elle a déplacé le wagon déjà, à cause du soleil, il ne faudrait pas qu'ils crèvent là-dedans, à cause de la chaleur, c'est une vraie fournaise lorsque le soleil donne sur la tôle. Avec sa barre de fer elle a l'habitude, elle la coince sous la caisse, s’arque-boute et se suspend de tout son poids – cinquante kilos à tout casser. Lentement le wagon avance. Elle ne supporte plus les cris du cochon qui lui tapent sur les nerfs, lui donnent la nausée, ni la transpiration qui mouille sa chemise, ce train qui n'arrive pas, Pierre toujours à travailler au loin, elle pousse la porte du buffet de la gare, complètement retournée, demande un couteau, très tranchant précise t-elle, et puis revient au wagon, coince sous elle le cochon pour que la tête déborde à l'extérieur, cherche comment s'y prendre, essaie de se souvenir des gestes qu'elle a vu faire le cœur battant donne à l'aveuglette un coup de couteau sous la gorge de l'animal surpris, une fois deux fois trois fois le sang les cris elle essaie encore et encore il ne veut pas se taire le sang les cris la tête qui pend elle est toute seule défaite empoissée les gars de la gare les mains enfoncées dans les poches en connaisseurs c'est pas de pot y'avait que ça à faire, ah ça c'est pas de pot. Madeleine s'essuie les mains, le front, Madeleine se reprend, Madeleine apprend à se faire une place respectée.
Elle passe assez vite son permis de conduire – elle a roulé sans, un certain temps - mais bien moins longtemps que Pierre. Les gendarmes ont attrapé son mari bien des fois, il envoyait Madeleine leur causer, elle devait mentir, prétendre qu'on avait perdu le fameux papier, les gendarmes n'insistaient pas. Au bout d'un certain temps la jeune femme roule seule dans son camion, avec jusqu'à cent petits cochons, ou soixante gros à l'arrière. Avale les kilomètres par centaines en fumant des cigarettes, en secret. C'est lourd à manœuvrer un bahut pareil, c'est dangereux quand la route est mouillée, ou boueuse, elle croit verser plus d'une fois. Un jour dans une courbe du côté de Paimpont, elle a Pierrick avec elle, ses bras et ses jambes tremblent tellement elle se cramponne au volant, elle sent le camion partir dans le virage, il est très chargé, il chasse, mais tient. Il tient, à un cheveu, elle baisse la vitre, sourit à son garçon, respire un grand coup. Chaque jour pendant des heures elle charge et décharge ses porcelets à la main. Quand elle rentre et qu'elle a tout vendu, elle s'inquiète au début des grosses sommes d'argent qu'elle transporte à vélomoteur depuis les Chèques Postaux de Rennes. Elle a cru parfois qu'on allait la dépouiller, des types en auto, qui l'attendent, la dépassent, font un bout de chemin, elle l'a dit à Pierre, il ne faut plus faire comme ça, j'ai peur.
Et puis cette autre fois aussi, elle en rit encore, Madeleine, la plaine de Baud, le triage de la gare de Rennes, ce cochon qui s'est échappé au sortir du wagon, et qui se sauve du côté de la Vilaine. On lui court derrière, il y a Marcel Maudet – un collègue - qui l'accompagne ce jour-là, on l'attrape par la queue, mais plus on tire, et plus il descend vers l'eau, tout le monde glisse, manque de tomber dans la flotte, et voilà le cochon à l'eau, qui nage nom de nom, et puis qui s'assoit au milieu de la Vilaine, comme ça sur une butte, un banc de sable, sur son derrière, qui se retourne et nous regarde, avec ses petits yeux intelligents. Puis il repart vers la berge d'en face, il fonce dans le linge d'une lavandière, il piétine tout le linge de la bonne femme - qui braille -, Madeleine se dit qu'on ne peut pas rester bras ballants, s'en va appeler les pompiers, court autant qu'elle peut, le temps qu'ils arrivent, le cochon est rendu dans le lotissement en face, les gens sont sortis de chez eux, s'interpellent, lèvent les bras, font des barrages, tout le monde fait la chasse au cochon ! « On a fini par l'avoir, on a payé un coup aux pompiers ».
Ils travaillent dur, Pierre et Madeleine, mais ils aiment se faire plaisir aussi. Après le boulot, ils partent en virées à Saint-Malo, vont au resto, traînent jusque tard le soir, elle, à son bras, sautillante, toujours bavarde et si vive, une petite hirondelle. Parfois ils vont à la mer, pique-niquer avec des amis. Se faire bronzer, nager pas trop. Madeleine a eu au début des années soixante un superbe maillot deux-pièces crème – qu'on trouverait exagérément couvrant aujourd'hui mais qui à l'époque lui avait valu d'être critiquée ouvertement, un jour, à Saint-Briac, malgré sa silhouette de sirène elle avait dû remballer ses affaires vite fait, et disparaître, huée presque.
Années soixante-dix – un vieux monde s'efface.
Comme pour le père, le progrès les a rattrapés. Les coopératives sont apparues, organisées, rentables, ruinant doucement le commerce des indépendants. Ça a été très dur. La belle-mère est décédée, Madeleine a dit j'arrête, je reprends le bar au champ Picot. Sa petite fille Laurence avait dix ans passés. Elle a fait des travaux, c'était après 1975, Pierre se faisait tirer l'oreille, elle a tout pris en main. Le modeste bistro qui servait le ballon de rouge sur le formica est devenu un endroit à la mode, un incontournable. Elle a choisi du neuf, du moderne, de la couleur, des parquets et des banquettes, et elle a fait installer des jeux électroniques, en location, des flippers clignotants super-sonores, remplacés souvent pour que les gens se lassent pas, a acheté un baby clinquant super-lourd, ça tournait du feu de dieu, on venait de loin, une vraie manne.
Derrière son bar, Madeleine rayonnait. « J'étais bien chez moi, j'avais l'impression d'être en vacances ! C'était plein de jeunes. Ils me tutoyaient. J'étais très à l'aise, j'aimais bien les jeunes. Ils me racontaient leurs petites histoires, leurs peines de cœur le samedi soir avant de partir en boîte, je les consolais, ils me faisaient confiance, je leur faisais confiance, ils avaient vingt ans, c'était presque mes enfants. » Pour eux elle avait acheté un juke-box. Elle adorait les chansons, se faisait présenter les nouveautés par un client proche qui vendait des disques, puis dans ces moments-là invitait sans façon ses habitués à venir écouter, choisir, elle, accoudée au bar laissait parler son cœur. Pierre Bachelet, Richard Cocciante (Un coup de soleil !), Cabrel (L'encre de tes yeux). Charlelie Couture pour les plus intellos. Julio Iglesias pour les femmes (Je n'ai pas changééé...). Un Brassens ou deux, obligé. Il y avait toujours de la musique, toute la journée. Pierre était par là en soirée, mais il ne se montrait pas, n'était pas à son aise avec le monde, et puis il ne voulait pas boire, il bricolait dans la cuisine derrière, regardait la télévision d'un œil distrait, gardait une oreille sur la salle, à tout hasard, des fois que Madeleine serait embêtée, des fois qu'elle aurait besoin de lui – mais c'était rare, elle avait une telle autorité sur son monde. Souvent elle lui disait d'ailleurs non Pierre, je préfère que tu restes là, tu comprends c'est mieux que je règle ça toute seule, on s'arrange mieux avec une femme, les hommes entre eux, des coqs qui se montent la tête, ne va pas donner de hardiesse plus qu'il n'en faut, reste donc, je t'appelle si j'ai besoin. Il est arrivé qu'elle ait peur, qu'elle ferme son bar plus tôt, que des voitures tournent sur le parking tous feux éteints, qu'un ivrogne contrarié ronfle toute une nuit dans la cour, que dans la voix de l'autre, lourde de menaces rentrées, elle sente le danger lui souffler sur la figure. Mais jamais elle ne s'est démontée. Toujours elle a gardé ce ton égal, elle a dit les choses avec netteté, sûre de son fait. Une seule fois on a appelé les gendarmes. Elle avait refusé à boire et les amis dans la salle n'avaient pas suffit à dissuader l'homme qui était revenu pour casser. C'était souvent pourtant qu'elle refusait de servir ceux qui avaient trop bu, elle sentait quand ils étaient chauds, tout de suite, elle avait le nez. Ramassés dans les mêmes coins, faces congestionnées, pesant mollement contre le bar, avec cette façon, d'un mouvement ralenti de la tête, de provoquer le monde autour. « Non, Néné, je ne te remets pas un Pastis, t'as assez bu comme ça, ça suffit, t'es énervé je vois bien, tu tapes sur mon bar, tu veux le casser c'est ça, je sais que tu mets du bordel chez les autres alors maintenant tu rentres chez toi ». L'autre partait fâché, restait six mois sans venir.
Les gendarmes appréciaient Madeleine pour cette intransigeance avec l'alcool. C'était elle la patronne, elle ne craignait personne. Elle, ne buvait jamais, question de principe – sinon elle aurait dû trinquer à chaque anniversaire ! « Les jeunes prenaient un diabolo ou un panaché. Les hommes un Ricard. Les femmes un Martini. Ou un kir. On venait pour la bonne ambiance. » On venait aussi rien que pour elle. La voir, l'approcher. Certains faisaient semblant d'être copains avec Pierre. C'est qu'elle était fameusement belle la femme à Pierre. Drôle aussi, et gaie, tous les jours. Mais elle savait les remettre à leur place. « Et si vous ne comprenez pas je vous préviens j'appelle » - et elle lançait un regard vers l'arrière-cuisine, lourd de sous-entendus, alors que Pierre était sur la route avec ses cochons ! Car elle servait dès le matin, juste le temps de faire son lit. Elle fermait après minuit, le temps d'un peu de ménage, elle dormirait cinq heures, c'était bien suffisant, il fallait qu'elle lise chaque soir quoi qu'il arrive. Pierre ronchonnait, tu me réveilles avec ta lumière, elle rétorquait, t'as déjà dormi, de quoi te plains-tu. Elle faisait mine d'éteindre, ne bougeait plus, attendait qu'il ronfle, sortait sa lampe torche. Souvent Pierre tâtonnait dans le noir, cherchait la main de Madeleine, il savait trouver un livre au bout. Elle rusait, changeait de main, ça finissait en rires, il savait qu'il ne l'emporterait pas. Elle était heureuse dans cette vie-là, elle était au sommet de sa vie, en pleine forme.
« À cinquante-quatre ans, sans prévenir, j'ai fait un malaise cardiaque grave. Depuis j'ai eu deux AVC. Il a fallu arrêter le bar. Ça a été très dur. Je ne savais plus quoi faire de moi. On avait un peu d'argent, on s'est mis à voyager, avec Pierre, le Portugal beaucoup. Et on allait danser. Mon mari était très bon danseur. On se connaissait par cœur, on ne formait plus qu'un, on était tout contre à se respirer et à tourner ensemble. Ça pouvait durer des heures. On allait à Sens le jeudi, et à Mordelles parce qu'il y avait de la danse bretonne, moi j'aimais ça. Passé soixante ans, on avait commencé à se connaître autrement, lui et moi. Au bout d'une vie presque. Parce qu'on avait le temps peut-être. Ou que j'avais failli y passer. On se tenait par la main, on était toujours à vouloir se toucher. J'aimais me blottir. Il m'embrassait sur le front, j'étais juste à la bonne hauteur. J'étais souvent grimpée sur ses genoux. Les gens trouvaient ça drôle. On a vécu comme ça jusqu'au bout. Et puis c'est lui qui est tombé malade. Il est parti d'un coup. Quinze jours avant on était encore à danser ».
C'était notre dernier entretien. Il aurait fallu, si j'avais su faire, en manière d'hommage, ébaucher au fusain, ou au simple crayon de bois, un portrait de l'hôtesse. Sa mince silhouette toute de noir vêtue, ses grands yeux épurés, le bel ovale de son visage généreux et ouvert, ce maintien, cette allure folle, à quatre-vingt cinq ans. Au lieu de cela, pour ne pas repartir sans rien, j'ai enregistré sa voix, son timbre clair, son rire enjoué, son amour pour Pierre. Le bar du Champ Picot n'existe plus. La grand-route passe encore devant l'ancien bâtiment, remanié, réhabilité. Une salle sûrement subsiste, plongée dans l'obscurité et le silence complet, où demeure à jamais, c'est certain, une partie de l'âme de Madeleine.
Comme pour le père, le progrès les a rattrapés. Les coopératives sont apparues, organisées, rentables, ruinant doucement le commerce des indépendants. Ça a été très dur. La belle-mère est décédée, Madeleine a dit j'arrête, je reprends le bar au champ Picot. Sa petite fille Laurence avait dix ans passés. Elle a fait des travaux, c'était après 1975, Pierre se faisait tirer l'oreille, elle a tout pris en main. Le modeste bistro qui servait le ballon de rouge sur le formica est devenu un endroit à la mode, un incontournable. Elle a choisi du neuf, du moderne, de la couleur, des parquets et des banquettes, et elle a fait installer des jeux électroniques, en location, des flippers clignotants super-sonores, remplacés souvent pour que les gens se lassent pas, a acheté un baby clinquant super-lourd, ça tournait du feu de dieu, on venait de loin, une vraie manne.
Derrière son bar, Madeleine rayonnait. « J'étais bien chez moi, j'avais l'impression d'être en vacances ! C'était plein de jeunes. Ils me tutoyaient. J'étais très à l'aise, j'aimais bien les jeunes. Ils me racontaient leurs petites histoires, leurs peines de cœur le samedi soir avant de partir en boîte, je les consolais, ils me faisaient confiance, je leur faisais confiance, ils avaient vingt ans, c'était presque mes enfants. » Pour eux elle avait acheté un juke-box. Elle adorait les chansons, se faisait présenter les nouveautés par un client proche qui vendait des disques, puis dans ces moments-là invitait sans façon ses habitués à venir écouter, choisir, elle, accoudée au bar laissait parler son cœur. Pierre Bachelet, Richard Cocciante (Un coup de soleil !), Cabrel (L'encre de tes yeux). Charlelie Couture pour les plus intellos. Julio Iglesias pour les femmes (Je n'ai pas changééé...). Un Brassens ou deux, obligé. Il y avait toujours de la musique, toute la journée. Pierre était par là en soirée, mais il ne se montrait pas, n'était pas à son aise avec le monde, et puis il ne voulait pas boire, il bricolait dans la cuisine derrière, regardait la télévision d'un œil distrait, gardait une oreille sur la salle, à tout hasard, des fois que Madeleine serait embêtée, des fois qu'elle aurait besoin de lui – mais c'était rare, elle avait une telle autorité sur son monde. Souvent elle lui disait d'ailleurs non Pierre, je préfère que tu restes là, tu comprends c'est mieux que je règle ça toute seule, on s'arrange mieux avec une femme, les hommes entre eux, des coqs qui se montent la tête, ne va pas donner de hardiesse plus qu'il n'en faut, reste donc, je t'appelle si j'ai besoin. Il est arrivé qu'elle ait peur, qu'elle ferme son bar plus tôt, que des voitures tournent sur le parking tous feux éteints, qu'un ivrogne contrarié ronfle toute une nuit dans la cour, que dans la voix de l'autre, lourde de menaces rentrées, elle sente le danger lui souffler sur la figure. Mais jamais elle ne s'est démontée. Toujours elle a gardé ce ton égal, elle a dit les choses avec netteté, sûre de son fait. Une seule fois on a appelé les gendarmes. Elle avait refusé à boire et les amis dans la salle n'avaient pas suffit à dissuader l'homme qui était revenu pour casser. C'était souvent pourtant qu'elle refusait de servir ceux qui avaient trop bu, elle sentait quand ils étaient chauds, tout de suite, elle avait le nez. Ramassés dans les mêmes coins, faces congestionnées, pesant mollement contre le bar, avec cette façon, d'un mouvement ralenti de la tête, de provoquer le monde autour. « Non, Néné, je ne te remets pas un Pastis, t'as assez bu comme ça, ça suffit, t'es énervé je vois bien, tu tapes sur mon bar, tu veux le casser c'est ça, je sais que tu mets du bordel chez les autres alors maintenant tu rentres chez toi ». L'autre partait fâché, restait six mois sans venir.
Les gendarmes appréciaient Madeleine pour cette intransigeance avec l'alcool. C'était elle la patronne, elle ne craignait personne. Elle, ne buvait jamais, question de principe – sinon elle aurait dû trinquer à chaque anniversaire ! « Les jeunes prenaient un diabolo ou un panaché. Les hommes un Ricard. Les femmes un Martini. Ou un kir. On venait pour la bonne ambiance. » On venait aussi rien que pour elle. La voir, l'approcher. Certains faisaient semblant d'être copains avec Pierre. C'est qu'elle était fameusement belle la femme à Pierre. Drôle aussi, et gaie, tous les jours. Mais elle savait les remettre à leur place. « Et si vous ne comprenez pas je vous préviens j'appelle » - et elle lançait un regard vers l'arrière-cuisine, lourd de sous-entendus, alors que Pierre était sur la route avec ses cochons ! Car elle servait dès le matin, juste le temps de faire son lit. Elle fermait après minuit, le temps d'un peu de ménage, elle dormirait cinq heures, c'était bien suffisant, il fallait qu'elle lise chaque soir quoi qu'il arrive. Pierre ronchonnait, tu me réveilles avec ta lumière, elle rétorquait, t'as déjà dormi, de quoi te plains-tu. Elle faisait mine d'éteindre, ne bougeait plus, attendait qu'il ronfle, sortait sa lampe torche. Souvent Pierre tâtonnait dans le noir, cherchait la main de Madeleine, il savait trouver un livre au bout. Elle rusait, changeait de main, ça finissait en rires, il savait qu'il ne l'emporterait pas. Elle était heureuse dans cette vie-là, elle était au sommet de sa vie, en pleine forme.
« À cinquante-quatre ans, sans prévenir, j'ai fait un malaise cardiaque grave. Depuis j'ai eu deux AVC. Il a fallu arrêter le bar. Ça a été très dur. Je ne savais plus quoi faire de moi. On avait un peu d'argent, on s'est mis à voyager, avec Pierre, le Portugal beaucoup. Et on allait danser. Mon mari était très bon danseur. On se connaissait par cœur, on ne formait plus qu'un, on était tout contre à se respirer et à tourner ensemble. Ça pouvait durer des heures. On allait à Sens le jeudi, et à Mordelles parce qu'il y avait de la danse bretonne, moi j'aimais ça. Passé soixante ans, on avait commencé à se connaître autrement, lui et moi. Au bout d'une vie presque. Parce qu'on avait le temps peut-être. Ou que j'avais failli y passer. On se tenait par la main, on était toujours à vouloir se toucher. J'aimais me blottir. Il m'embrassait sur le front, j'étais juste à la bonne hauteur. J'étais souvent grimpée sur ses genoux. Les gens trouvaient ça drôle. On a vécu comme ça jusqu'au bout. Et puis c'est lui qui est tombé malade. Il est parti d'un coup. Quinze jours avant on était encore à danser ».
C'était notre dernier entretien. Il aurait fallu, si j'avais su faire, en manière d'hommage, ébaucher au fusain, ou au simple crayon de bois, un portrait de l'hôtesse. Sa mince silhouette toute de noir vêtue, ses grands yeux épurés, le bel ovale de son visage généreux et ouvert, ce maintien, cette allure folle, à quatre-vingt cinq ans. Au lieu de cela, pour ne pas repartir sans rien, j'ai enregistré sa voix, son timbre clair, son rire enjoué, son amour pour Pierre. Le bar du Champ Picot n'existe plus. La grand-route passe encore devant l'ancien bâtiment, remanié, réhabilité. Une salle sûrement subsiste, plongée dans l'obscurité et le silence complet, où demeure à jamais, c'est certain, une partie de l'âme de Madeleine.



 Engagés
Engagés